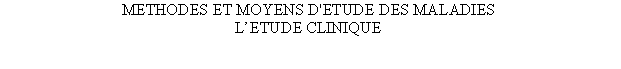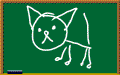
|
SMS-ST2S |
|
Le site du labo de Bio |

|
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE HUMAINES |
|
Quand le patient se présente pour la première fois chez un praticien, celui-ci lui demande d'abord son nom, son âge, sa profession, son adresse, des détails sur sa famille, etc. Vient ensuite l'anamnèse proprement dite. Comme il est souvent difficile pour le malade de distinguer les points essentiels des points accessoires, le médecin lui pose systématiquement des questions sur le début de l'affection, son évolution, ses différentes manifestations, et en viendra ensuite aux plaintes actuelles. Leur cause n'étant généralement pas toujours évidente à première vue, il procédera, s'il y a lieu, à une anamnèse générale. Il demandera au malade des renseignements au sujet des affections survenues dans sa famille, pour dépister des hérédités éventuelles. Il s'informera aussi de ses antécédents pathologiques, c'est-à-dire des maladies dont il a souffert auparavant. L'anamnèse C'est l'ensemble des questions posées par le médecin au patient avant tout examen médical. Il s'agit, pour le praticien, d'enregistrer les plaintes du malade, qui traduisent les symptômes de son affection, et d'en déceler, par le dialogue, les particularités. L'anamnèse permettra de remonter jusqu'au diagnostic d'une maladie déterminée; L'anamnèse est, en quelque sorte, l'historique de la maladie. Elle comprend aussi l'examen clinique, et parfois, des examens complémentaires effectués par des spécialistes. Une fois toutes les données rassemblées, le médecin posera un diagnostic et proposera un traitement. Les diverses phases de l'affection, l'effet de la thérapeutique, le pronostic (l'évolution probable ou possible) font également partie de l'histoire de la maladie. Dans les hôpitaux, on a pris l'habitude d'utiliser des dossiers et des formulaires standardisés pour consigner tous ces éléments et s'y référer si nécessaire. En général, le malade donne sur lui-même des renseignements suffisants: c'est ce qu'on appelle l'auto-anamnèse. S'il n'est pas en état de le faire, soit parce qu'il est trop jeune ou trop âgé ou inconscient, le médecin interrogera ses proches; il s'agira alors d'hétéro-anamnése. L'examen clinique La première phase de l'examen somatique général est l'inspection, c'est-à-dire l'examen du corps partiellement ou entièrement dénudé, au repos ou en mouvement. Des rougeurs, des boutons, une douleur bien localisée seront des signes objectifs permettant d'orienter rapidement le diagnostic. Un deuxième temps de l'examen clinique affinera l'orientation diagnostique. Le médecin procèdera alors à:
La palpation Cette partie de l'examen consiste à presser certains endroits du corps avec la main et les doigts afin d'évaluer la forme, la consistance, la taille des organes, abdominaux par exemple, Par la même occasion, le médecin se fait une opinion en ce qui concerne la température de la peau, la présence éventuelle d'indurations, la tonicité des muscles, l'existence d'une résistance musculaire, passive ou active à la mobilisation, etc. La percussion Cette technique consiste a frapper, de l'extrémité d'un doigt replié, la phalange terminale d'un doigt (généralement le médius) de l'autre main, celle-ei étant tenue à plat sur la partie du corps à examiner. Le procédé est surtout utilisé pour l'examen des organes thoraciques et abdominaux. Le son obtenu permet d'apprécier l'état de ces organes. En percutant la paroi thoracique, un médecin peut délimiter la place, la forme et la taille du massif formé par le coeur entre les poumons remplis d'air ou mettre en évidence des accumulations de liquide dans la cavité thoracique et divers symptômes pulmonaires telle une hépatisation. La définition du son obtenu par la percussion est notamment déterminée par la quantité d'air contenue dans les organes internes et par l'état des tissus environnants. On distingue trois types de sonorités: 1. La sonorité normale. C'est un son relativement fort mais assez bas, provoqué entre autres par la percussion de poumons remplis d'air. 2. La matité. C'est un son bref, d'intensité limitée. On l'enregistre en percutant un organe plein, par exemple le foie à l'état normal 3. Le tympanisme. C'est un son plus élevé. On l'obtient notamment en percutant l'abdomen normal, dont les anses intestinales sont remplies de gaz. Il existe évidemment des sonorités intermédiaires. Le but de la percussion est de délimiter les organes remplis d'air et ceux qui n'en contiennent pas. Ensuite, de mettre en évidence les modifications pathologiques touchant les organes, que traduit le changement de sonorité. L'auscultation Contrairement à ce que l'on croit volontiers, l'auscultation n'est qu'une phase de l'examen médical: celle pendant laquelle le praticien écoute les bruits engendrés par les fonctions corporelles. Par exemple, le murmure émis par l'activité respiratoire. Grâce à l'auscultation, le médecin apprécie le fonctionnement d'un organe,sans utiliser pour autant des instruments compliqués. A l'aide d'un simple stéthoscope, il écoutera les poumons, le coeur mais aussi la palpitation des vaisseaux sanguins essentiels, lors d'une prise de tension, ainsi que les organes abdominaux. Les bruits perçus sont déterminés principalement par l'air contenu dans les organes internes, tout en étant influencés par les tissus environnants. * Lors de l'auscultation des poumons, le patient doit inspirer et expirer en position assise, debout ou couchée. Il expire généralement par la bouche. Pour apprécier exactement la respiration, le médecin écoute les divers mouvements inspiratoires et expiratoires successifs. Il enregistre ainsi ce qu'on appelle le murmure vésiculaire. Parfois s'ajoutent des bruits appelés râles ou ronchi, lorsque l'air se frotte à du mucus épais, notamment lors d'inflammation des bronches, ou quand l'air barbote dans un milieu humide, ce qui est le cas des râles humides. * L'auscultation du coeur: Pour entendre les bruits cardiaques, le médecin place son stéthoscope aux endroits du thorax où il entend le claquement des valvules, l'expulsion du sang et le myocarde. Afin de les enregistrer d'une façon aussi exacte que possible, il pose successivement son stéthoscope à quatre endroits sur la paroi thoracique. De cette manière, on perçoit éventuellement les souffles cardiaques. Les bruits cardiaques sont produits par les vibrations des parois vasculaires et cardiaques. Il y a souffle cardiaque lorsque le flot sanguin passe d'un cours tranquille à un mouvement tourbillonnant. Pour des raisons pratiques, le médecin parle de tons quand les bruits sont courts et de souffles quand ils se prolongent un peu plus longtemps. Pendant une contraction cardiaque, on enregistre différents tons. Le premier se produit au moment de la fermeture brutale des valvules séparant l'oreillette des ventricules; le deuxième correspond à la fermeture des valvules qui séparent le ventricule droit de l'artère pulmonaire et le ventricule gauche de l'aorte. Il arrive qu'un troisième et même un quatrième tons soient émis: le troisième pendant un remplissage rapide du coeur et le quatrième au moment de la contraction des oreillettes, au cours de laquelle un courant sanguin rapide passe de celles-ci dans les ventricules. Ces deux derniers tons sont communément audibles chez les jeunes et chez les athlètes entraînés. Chez l'adulte, le souffle cardiaque n'existe généralement qu'en cas de manifestations pathologiques. Chez l'enfant, au contraire, on enregistre un grand nombre de souffles dits « fonctionnels », qui ne traduisent une anomalie ni de fonctionnement, ni de structure du coeur. L'examen des réflexes Par l'examen des réflexes cutanés et tendineux, le praticien contrôle le fonctionnement des nerfs périphériques, de la moëlle épinière et du cerveau. |