
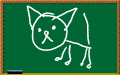
|
SMS-ST2S |
|
Le site du labo de Bio |

|
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE HUMAINES |
|
EXERCICES CHAPITRE 4 |
|
.Exercice 1 QCM 1. a) Faux. Les lipides entrant dans la composition d'une membrane plasmique sont les phospholipides et le cholestérol. b) Vrai. c) Faux en nombre, pas en masse. Les lipides sont des molécules plus petites que les protéines: pour un pourcentage équivalent de lipides et de protéines, les lipides seront beaucoup plus nombreux dans une membrane plasmique. d) Faux. La membrane des hématies contient environ 49% de protéines, 43% de lipides et 8% de glucides. La gaine de myéline est constituée de 20% de protéines et 80% de lipides. Les variations de compositions des membranes sont liées à leurs différences de fonctions. e) Faux. Les phospholipides représentent 55% des lipides soit 23,6 % des constituants de la membrane. Les glycolipides représentent 7% des glucides soit 0,56% des constituants membranaires. 2. a) Faux. Tout dépend de la spécialisation de la membrane, les lipides sont en général les constituants majoritaires. b) Faux. Le déplacement d'une couche à l'autre de la membrane (flip-flop) est assez rare, d'où l'asymétrie des membranes au niveau lipidique. Par contre, le déplacement latéral est possible. e) Vrai. Les lipides entrant dans la composition d'une membrane sont les phospholipides et le cholestérol. d) Vrai. La présence de protéines dans une membrane dépend de son activité. La membrane interne d'une mitochondrie, siège de la respiration cellulaire, possède trois fois plus de protéines que la membrane externe. e) Faux. Les phospholipides présents sur les deux faces de la membrane peuvent être différents (présence en majorité de phosphatidylcholine et de sphingomyéline sur la face extracellulaire et de phosphatidylsérine et de phosphatidyléthanolamine sur la face intracellulaire). Les glucides sont présents sur la face extracellulaire, ils forment le glycocalyx (résidus glucidiques associés à des lipides ou des protéines). 3. a) Faux. Les endomembranes sont localisées: - autour du noyau, elles forment l'enveloppe nucléaire; - dans le cytoplasme, elles délimitent certains organites (REG, mitochondrie, ...). b) Faux. Cela dépend de leur localisation. La quantité de protéines peut varier, elle dépend de l'activité de la membrane. c) Vrai. d) Faux. Les endomembranes des mitochondries contiennent des protéines. e) Vrai. 4. a) Vrai. b) Vrai. c) Vrai. d) Faux. Une pompe ou protéine transporteuse permet un transport actif des solutés. Le transport actif (ATP !) permet le passage d'un soluté dans le sens inverse du gradient de concentration, du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. e) Vrai. 5. a) Vrai. b) Faux. L'enveloppe nucléaire est formée d'une double membrane percée de pores. c) Faux. La membrane externe de l'enveloppe nucléaire ne porte pas de glycocalyx : le glycocalyx est présent sur la face externe d'une membrane plasmique. d) Vrai. e) Vrai. 6. a) Vrai. b) Faux. L'ADN est présent uniquement dans le noyau. Mais présence aussi dans les mitochondries, donc dans le cytoplasme c) Faux. L'ADN est constitué de désoxyribonucléotides. Les ribonucléotides sont les constituants de l'ARN. d) vrai. J’aurais préféré dans l’ordre, Pi, Sucre, BA e) Faux. L'adénine se lie à la thymine et la cytosine se lie à la guanine. Exercice 2 1. Molécule qui possède une double polarité --> je dirais tout simplement molécule bipolaire …et il y en a des masses. Nathan attend : phospholipide (ou protéine intrinsèque). 2. Molécule qui traverse la totalité de la bicouche lipidique --> protéine transmembranaire. 3. Type d'endomembrane délimitant la mitochondrie -->. double endomembrane. ( ????) 4. Nom du mécanisme permettant le passage d'un soluté du milieu hypertonique vers le milieu hypotonique --> transport passif. Ça s’applique aussi aux gaz... 5. Nom de la molécule diffusant au travers de la membrane par osmose --> eau. 6. Type de transport nécessitant de l'énergie --> transport actif. 7. Molécule formée par un enchaînement de ribonucléotides --> ARN. Exercice 3 1. 1 : résidu glucidique; 2 : protéine extrinsèque; 3 : glycoprotéine; 4 : résidu glucidique; 5 : phospholipide; 6 : glycolipide; 7 : bicouche phospholipidique, 8 : canal protéique; 9 : protéine intrinsèque; 10 : protéine extrinsèque. 2. Les glycoprotéines forment le glycocalyx. Le glycocalyx intervient dans les phénomènes de reconnaissance entre les cellules. Des cellules spécialisées possédant le même glycocalyx se reconnaissent et s'associent pour former des tissus. Les cellules ayant un glycocalyx différent sont reconnues comme étrangères et détruites par le système immunitaire. Le glycocalyx sert de marqueur de l'identité cellulaire, il est à l'origine des groupes sanguins. Le glycocalyx se situe uniquement sur la face extracellulaire des membranes plasmiques, cette localisation est adaptée à sa fonction de reconnaissance. Sa répartition est responsable de l'asymétrie des membranes. 3. Un canal protéique permet le passage de petites molécules hydrophiles et d'ions. Ce transfert s'effectue par diffusion simple, en suivant le gradient de concentration. 4. La molécule absente de la représentation est le cholestérol. Le cholestérol est une molécule courte et rigide qui se localise dans les espaces laissés entre les molécules des phospholipides. Il est présent dans les deux couches de la membrane. Le cholestérol rend la bicouche plus rigide. 5. La membrane plasmique est formée d'un agencement de lipides et de protéines. Ces molécules se déplacent et se renouvellent de façon permanente au sein de la membrane: elle subit des modifications spatio-temporelles continuelles d'ou le terme de mosaïque fluide. La fluidité de la membrane dépend de sa composition lipidique (en fonction de la quantité de cholestérol) et de la température. Exercice 4 cf p 257 Exercice 5 1. - Le transport 1 représente un transport passif. Le transfert des molécules se réalise par diffusion simple dans le sens du gradient de concentration ou de pression. - Le transport 2 représente un transport passif. Les molécules empruntent une protéine de transport pour diffuser au travers de la membrane plasmique. Ce transfert se réalise dans le sens du gradient de concentration. C'est un transport par diffusion facilitée. - Le transport 3 représente un transport actif. Le transfert du soluté se réalise contre le gradient de concentration: il nécessite l'utilisation d'une protéine transporteur et d'énergie par hydrolyse de l'ATP. 2. Ce sont des transports passifs, qui diffèrent par la vitesse de diffusion des solutés. La vitesse de passage des solutés par diffusion simple est proportionnelle à leur concentration : plus la concentration est élevée et plus le passage d'un côté à l'autre de la membrane est rapide. La vitesse de passage d'un soluté par diffusion facilitée est plus rapide que par une diffusion simple, mais elle est limitée par le nombre de protéines de transport et par leur saturation. Lorsque toutes les protéines de transport sont saturées, la vitesse de transfert devient maximale et constante. On parle de substance à seuil (cf rein et tt du glucose) 3. Le transport 1 permet le transfert de petites molécules hydrophobes (O2 CO2 N2) ou de petite molécules polaires (= hydrophiles) non chargées (H2O, éthanol). Le glucose (molécule polaire non chargée) ne possède pas une taille suffisamment petite pour pouvoir diffuser entre les phospholipides: il doit emprunter une protéine de transport pour traverser la membrane, puisque celle-ci lui est imperméable. 4. a) En utilisant un transport actif, le calcium se déplace contre le gradient de concentration, c'est-à-dire d'un milieu hypotonique vers un milieu hypertonique. b) En absence d'ATP, la pompe ne pivote pas dans la membrane. C'est l'hydrolyse de l'ATP qui assure sa rotation et le transfert du soluté vers le milieu hypertonique. Ici le calcium n'est pas transféré vers le milieu hypertonique. NB hypertonique ou hypotonique tout seul ne veut rien dire : i faut préciser hypotonique au plasma, par exemple. 5. La membrane plasmique possède une perméabilité sélective. La zone hydrophobe, créée par les queues des phospholipides au sein de la bicouche, entrave le passage de la plupart des molécules hydrophiles et des ions. Seules les petites molécules hydrophobes (O2 CO2 N2), hydrophiles non chargées (H2O, éthanol), peuvent la traverser par diffusion simple. Les molécules hydrophiles de taille plus grande (acides aminés, glucose, nucléotides) et les ions doivent emprunter un transporteur membranaire : les protéines de transport transmembranaires ou des canaux protéiques. - Les molécules peuvent diffuser dans le sens du gradient de concentration: le passage d'une molécule d'un milieu hypertonique vers un milieu hypotonique (= sens du gradient) se réalise par diffusion simple ou par diffusion facilitée. Ces deux diffusions sont des transports passifs. Un soluté peut traverser une membrane plasmique contre le gradient de concentration en empruntant une pompe membranaire. Ce transport nécessite l'utilisation d'ATP : c'est un transport actif. En l'absence d'ATP le transfert ne peut pas se réaliser. Exercice 7 1. 1 : bases complémentaires; 2 : désoxyribose (sucre en CS); 3 : groupement phosphate; 4 : base azotée; 5 : liaisons hydrogène. 2. A-T et C-G 3. L'unité de base de l'ADN est le nucléotide, ou plus précisément désoxyribonucléotide. Il est composé d'une base azotée, d'un désoxyribose et d'un groupement phosphate. 4. Homme: A/T = 1,05; C/G = 0,99. E. Coli: A/T = 1,04; C/G = 1,01. Mouton: A/T = 1,03; C/G = 1,01. Saumon: A/T = 1,02; C/G = 1,01. Blé: A/T = 1,00; C/G = 0,99. 5. Chaque organisme présente un rapport A/T et C/G proche de 1, ce qui signifie qu'il existe autant de base A que de base T et autant de base C que de base G. Mot clé ? COMPLEMENTARITÉ |