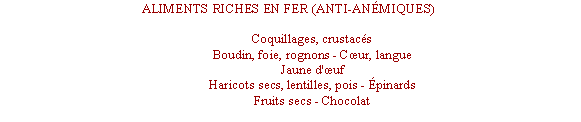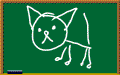
|
SMS-ST2S |
|
Le site du labo de Bio |

|
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE HUMAINES |
|
Examens biologiques |
|
Savoir définir chaque type d'examen (biochimique, bactériologique, virologique, parasitologique, immunologique, hématologique) et donner les principales indications Examens biologiques de routine L'examen des "humeurs" fait partie des observations de routine, demandées tant par le médecin de famille que par le spécialiste. La recherche d'anomalies ne se limite pas au sang et à l'urine, elle peut se faire sur le contenu de l'estomac, la salive, les crachats, les selles, le LCR, la sueur, etc... Des méthodes chimiques très simples, permettant une orientation rapide, sont utilisées pour l'examen du sang et de l'urine. En quelques secondes, on met en évidence la présence de sucre ou d'albumine dans l'urine, en y plongeant une bandelette de réactif spécifique qui change de couleur lorsque la substance recherchée est incorporée à l'urine. Cependant, ces tests rapides ne donnent qu'un résultat approximatif; des erreurs étant possibles, il est donc nécessaire, en cas de test positif d'effectuer en laboratoire des examens complémentaires. Aujourd'hui, les analyses chim1iques sont pratiquement automatisées au laboratoire, ce qui réduit au minimum les manipulations humaines. Une analyse de plasma,par exemple, se fait en quelques secondes par des systèmes opto-électroniques disposant de lasers de longueurs d'ondes différentes permettent une lecture des densités optiques, analysant les couleurs de pastilles réactives etc... L'examen microscopique permet de déceler la présence de micro-organismes dans les humeurs ou d'anomalies dans des cellules, notamment dans les cellules sanguines. De plus en plus fréquemment, on dose les enzymes produites par les cellules, (les enzymes ont la propriété d'accélérer ou de rendre possibles certaines réactions organiques). Leur absence ou leurs modifications, y compris celle de leur taux, constituent une bonne indication dans l'étude de certains troubles métaboliques de tel ou tel organe (cf test de Guthrie). Examens spécialisés La plupart des hôpitaux mettent, aujourd'hui, tout un appareillage moderne à la disposition des médecins qui souhaitent pratiquer des examens spécialisés. On peut notamment prélever par aspiration, avec une aiguille, une petite quantité de liquide au sein d'un tissu ou d’un organe. Ce liquide est ensuite examiné grâce à des techniques chimiques et microscopiques. C'est ce qu'on appelle une ponction. * La biopsie consiste à prélever, au sein d'un tissu ou d'un organe un fragment cellulaire qui est ensuite étudié sur le plan anatomopathologique. Le caryotype Examen cytologique permettant l'analyse chromosomique. Il nécessite de nombreuses cellules en division . En effet, c'est au stade de la métaphase des mitoses (ou des méioses) que les chromosomes sont visibles. Si la méiose ne peut être étudié qu'au niveau des cellules sexuelles (gamètes), la mitose peut l'être au niveau de tous les tissus somatiques. On choisira de préférence un tissu à multiplication rapide. (Epithélium germinal, moelle osseuse, rate, ganglions lymphatiques).... Les techniques d'observation directes de multiplications nécessitent une biopsie, donc le procédé sera sans doute rapide, mais couteux et parfois douloureux. On pourra leur préférer des techniques indirectes, n'exigeant que des cellules pouvant être obtenues facilement (sang, peau...). Les cellules devront être mises en culture environ 72 heures avant d'obtenir des cultures en division. Pratiquement : on utilise 2 à 3 gouttes de sang, placées dans un milieu de culture adapté aux lymphocytes. Au bout de 72 heures, la division cellulaire est bloquée au stade de la métaphase par la colchicine (antimitotique que l'on rencontrera aussi dans les traitements anticancéreux, pour les mêmes raisons). On fera éclater les cellules par choc osmotique (endosmose suivie de lyse cellulaire) et on photographiera les chromosomes, bien identifiables à ce stade. On découpe, on classe principalement suivant la taille et la position du centromère, Les résultats peuvent être obtenus au bout de quelques jours en principe. A noter qu'on pratique aujourd'hui parfois en prophase: les chromosomes sont plus fins et moins condensés, mais il y apparaît plus de "bandes" permettant l'identifications de certaines zones recherchées. Nombreux sites intéressants sur la caryotype... Réalisation simple (niveau collège) http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/svt/pratikp/college/exercis/3eme/caryotype.htm Réalisation plus technique (votre niveau) http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/svt/info/logiciels/genetic/caryot/caryotsexecons.htm LA N.F.S. L'hémogramme ou Numération-Formule Sanguine, est l'étude des cellules normales ou non circulant dans le sang. C'est un examen courant, pratiqué en particulier lorsqu'on subodore une anémie, une infection, une allergie ou une parasitose, une leucémie... L'hémogramme est également systématique chez tout malade absorbant des médicaments dangereux pour les globules sanguins ou traité par radiothérapie. Chez l'adulte il y a environ cinq litres de sang constitué d'une partie liquide appelée plasma, et de cellules sanguines, les globules. (le rapport globules/sang constitue l'hématocrite) Les cellules sanguines sont de trois sortes : Les globules rouges, hématies ou érythrocytes Ce sont de petites cellules arrondies, discoïdes, de #7µ de diamètre. Ces cellules ont pour constituant essentiel l'hémoglobine, substance riche en fer, qui donne aux hématies donc au sang leur couleur et dont le rôle est de transporter l'oxygène à travers le corps. Les globules rouges, comme tous les globules d'ailleurs, naissent dans la moelle rouge des os. Adultes il passent dans le sang où ils ne survivront que pendant environ 120 jours. Leur surface porte des substances particulières: des antigènes, qui permettent de classer les individus selon leur groupe sanguin (A, B, AB ou 0, Rhésus positif ou négatif, Kell, Dufy, etc...). Normalement il y a 4,5 millions de globules rouges par millimètre cube de sang. Les globules blancs ou leucocytes Ce sont des cellules mobiles, capables de sortir des vaisseaux sanguins (Diapédèse) et dont la fonction essentielle est de lutter contre les antigènes. Selon leur aspect on distingue dans la famille des leucocytes les granulocytes (anciennement: polynucléaires) et les mononucléaires. - Parmi les granulocytes: trois espèces: Les neutrophiles spécialisés dans la lutte contre les bactéries (phagocytose) , les éosinophiles qui sont en cause dans les infections parasitaires et les basophiles réagissant en cas d'allergies. Les granulocytes naissent dans la moelle rouge des os, comme les hématies. - Les mononucléaires se divisent en: macrophages, capables de phagocytose Lymphocytes B: fabriquent des anticorps. Lymphocytes T: éléments de la réponse cellulaire à l'infection. Lymphocytes K et NK, dirigés contre les cellules tumorales. Le nombre de globules blancs est de 7 000 à 8 000 par millimètre cube de sang.
Ce sont des fragments de cellules géantes (appelées mégacaryocytes), présentes dans le sang et qui ont la particularité de s'agglutiner pour faire cesser les hémorragies. Le nombre des plaquettes est de 300 000 environ par millimètre cube de sang. RESULTATS NORMAUX DE L'HÉMOGRAMME A la naissance un enfant possède environ 6 millions de globules rouges par millimètre cube de sang, au bout de quelques jours de vie ce nombre diminue pour atteindre 4,5 ou 5 millions. Cette destruction normale des hématies est l'hémolyse physiologique du nouveau-né qui peut provoquer une petite jaunisse ou ictère. Chez le nouveau-né et le petit enfant il est normal que les globules blancs soient augmentés et atteignent le nombre de 15 à 20 000 par millimètre cube à la naissance. Le nombre normal ne sera atteint que vers 8 ou 10 ans. HÉMOGRAMME NORMAL Numération globulaire Leucocytes 5 100 /mm3 (4 000-10 00) Hématies 4 490 000 /mm3 (4.0-5.7) Hémoglobine 14.40 g % (12.0 à 17.0) Hématocrite 42.90 % (33.0 à 52.0) V.G.M. 95.55 µ3 (80-100) Formule leucocytaire Polynucléaires neutrophiles 54 % soit 2 244/mm3 éosinophiles 2 % soit 102/mm3 basophiles 1 % soit 51/mm3 Lymphocytes 36 % soit 2 346/mm3 Monocytes 7 % soit 357/mm3 Résultats anormaux de l'hémogramme Chaque espèce de globules sanguins peut être diminuée ou augmentée en quantité. Les hématies Leur nombre peut être diminué, il s'agit d'anémies, ou au contraire augmenté, il s'agit de polyglobulies. L'anémie correspond à un manque de globules rouges dans le sang (moins de 3 500 000/mm3). L'anémique est pâle, fatigué, s'essouffle, son coeur bat vite (tachycardie). On observe des anémies en cas d'hémorragies gynécologiques ou digestives (ulcère d'estomac), chez la femme dont les règles sont trop abondantes, les personnes manquant de fer, après opération de l'estomac par gastrectomie, chez les personnes carencées en vitamine B12 et en protéines (vieillards après infections microbiennes, au cours de traitements anticancéreux par chimiothérapie...
- Les polyglobulies : elles sont beaucoup plus rares et s'observent chez des malades qui respirent mal du fait d'une insuffisance respiratoire chronique (emphysème, bronchite), d'un séjour prolongé en altitude ou qui sont victimes d'une tumeur (cancer du rein...). Les leucocytes Leur nombre peut être augmenté dans son ensemble (polynucléose, leucocytose) ou au contraire diminué (neutropénie, leucopénie). Généralement une seule lignée est concernée, ce qui oriente vers une maladie précise dont le diagnostic nécessitera souvent d'autres examens que l'hémogramme. - Les polynucléaires neutrophiles sont surtout augmentés en cas d'infection bactérienne et ceci ne renseigne pas sur l'endroit où se développent les microbes. Il peut s'agir d'une appendicite, d'une infection urinaire, d'un abcès dentaire ou d'une bronchite. Seule l'écoute attentive des plaintes ou doléances du patient peut renseigner l'équipe médicale. - Les polynucléaires neutrophiles sont au contraire abaissés au-dessous de 50 %: * au cours des infections de l'organisme par des virus : hépatite, rougeole, rubéole, mononucléose infectieuse, Sida, * après exposition aux --« rayons » (irradiation accidentelle, radiothérapie), maladie parasitaire (paludisme, toxoplasmose)..., *.suite à une intoxication par des produits industriels (benzène, benzol), des traitements par le chloramphénicol, les antipaludéens, les antiépileptiques ou les antigoutteux (colchicine). - Les polynucléaires éosinophiles sont augmentés: * au cours des parasitoses, c'est-à-dire lorsque des vers se développent dans l'intestin : oxyures, ascaris, ténias, douves..., * chez les individus allergiques à des substances naturelles comme les plumes ou la poussière, ou médicamenteuses comme les produits radiologiques, les pénicillines ou les antiépileptiques. - Les monocytes, lymphocytes sont augmentés au cours des maladies infectieuse causées par des virus (hépatite, mononucléose infectieuse, rubéole, zona..) mais parfois diminuent également dans des maladies virales comme le Sida qui provoque une destruction des lymphocytes et une diminution mortelle des défenses contre l'ennemi. Par ailleurs les globules blancs sont augmentés dans le sang en cas de leucémie. Les plaquettes Elles sont augmentées dans le sang lors de rares maladies appelées thrombocytoses. L'excès de ces fragments de cellules provoque des caillots ou thrombus dans les vaisseaux sanguins. Inversement l'organisme peut manquer de plaquettes, ce sont les thrombopénies dues à certains médicaments ou au mauvais fonctionnement de la moelle des os, en particulier lors des leucémies. Si une personne manque de plaquettes sanguines, elle fait plus facilement des hémorragies en cas de plaie. |