
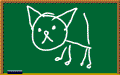
|
SMS-ST2S |
|
Le site du labo de Bio |

|
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE HUMAINES |
|
Myopathies de Duchenne et de Becker : premier pas vers une thérapie génique Le premier essai de phase I de thérapie génique pour les myopathies de Duchenne et de Becker vient de démontrer qu'il est possible d'exprimer la dystrophine à partir d'une molécule d'ADN injectée directement dans les muscles des malades. A l'occasion du congrès annuel de la Société américaine de thérapie génique, les résultats du premier essai de phase I de thérapie génique pour les myopathies de Duchenne et de Becker sont rendus publics. Ils sont très encourageants puisqu'ils montrent qu'il est possible d'exprimer, dans les muscles des malades, une version fonctionnelle du gène dont la déficience est à l'origine de ces deux pathologies. Les myopathies de Duchenne et de Becker sont deux maladies musculaires génétiques causées par la mutation du gène codant pour la dystrophine. Il n'existe actuellement aucun traitement curatif pour ces deux pathologies gravement invalidantes. La thérapie génique représente cependant un espoir important pour les patients atteints par ces dystrophies musculaires. En effet, le transfert d'un gène fonctionnel dans leurs cellules musculaires pourrait théoriquement permettre aux malades de synthétiser la dystrophine qui leur fait défaut. Un plasmide injecté dans les muscles La molécule d'ADN exogène qui porte le gène « médicament » codant pour la dystrophine a été conçue par la société Transgene. Il s'agit d'un plasmide (une petite molécule d'ADN circulaire) capable de se multiplier dans les cellules humaines. Ce plasmide a été administré aux malades directement par injection intramusculaire. Il faut encore un lourd travail de recherche « C'est un premier pas vers une thérapie génique des myopathies de Duchenne et Becker », explique le Pr Michel Fardeau. Cependant, avant qu'un protocole thérapeutique effectif puisse être proposé aux malades, un lourd travail de recherche devra être réalisé. En améliorant la structure du plasmide, vecteur du transfert de gène, en augmentant les doses de plasmide administré et en modifiant la voie d'administration, les chercheurs espèrent notamment augmenter le nombre de cellules qui expriment la protéine « médicament » à la suite d'une injection d'ADN et le niveau d'expression de la protéine dans chacune de ces cellules. Elodie BIET |